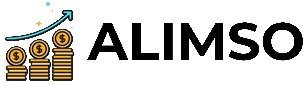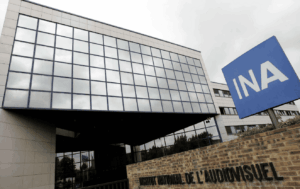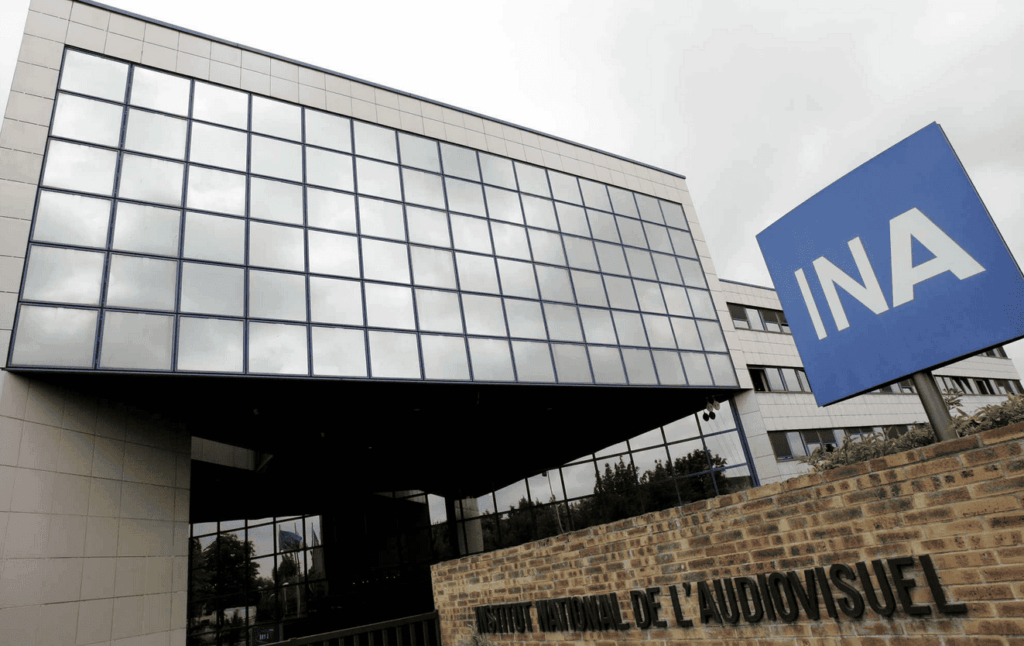
En 2025, l’Institut national de l’audiovisuel (INA) célèbre un demi-siècle d’existence. Cinquante ans après sa création, cet établissement public continue de jouer un rôle central dans la préservation du patrimoine audiovisuel français. L’année en cours est riche en évolutions technologiques pour l’INA, en efforts de numérisation des archives analogiques, mais aussi en événements institutionnels marquants. Entre mission patrimoniale, innovations numériques et bouleversements à sa tête, tour d’horizon de l’actualité de l’INA en 2025.
Cinquante ans de mémoire audiovisuelle française
Créé en janvier 1975 dans le sillage de la réforme de l’ORTF, l’INA a hérité des archives historiques de la radio-télévision publique française. Depuis, ses collections n’ont cessé de s’enrichir au fil des dépôts des chaînes nationales, constituant l’une des plus vastes bases d’archives audiovisuelles au monde. Chargé par la loi de sauvegarder et valoriser ces fonds, l’INA s’est imposé comme le gardien de la mémoire audiovisuelle nationale. Ses réserves couvrent aujourd’hui plus de 70 ans de programmes radio et 60 ans de télévision. Grâce au dépôt légal – étendu en 1992 aux émissions de radio et TV – l’INA collecte en continu les flux de près de 179 chaînes audiovisuelles. À la fin de 2019, ce fonds numérique représentait déjà plus de 18,6 millions d’heures de programmes stockés, un chiffre encore accru depuis. Cette masse d’archives alimente la mission patrimoniale de l’institut, mais aussi de nombreuses publications, expositions et documentaires qui revisitent l’histoire récente à partir des images et sons conservés.
En 2025, alors que l’INA atteint ses 50 ans, le contexte est propice aux bilans et perspectives. L’audiovisuel public français dans son ensemble fête également un cinquantenaire, celui de la fin du monopole de l’ORTF et de la naissance des sociétés actuelles. L’INA profite de cet anniversaire pour souligner son rôle unique : préserver la mémoire collective à travers les archives. Tout au long de l’année, l’institut met en avant des contenus commémoratifs et éducatifs liés aux grandes dates. Par exemple, il s’est associé à France Télévisions pour marquer les 50 ans de la loi Veil sur l’interruption volontaire de grossesse – promulguée en janvier 1975, la même année que la création de l’INA. En février 2025, une master class a réuni des lycéens autour du thème « Simone Veil et les 50 ans d’un combat pour la liberté », dans le cadre de Lumni (la plateforme éducative de l’audiovisuel public coéditée par France TV et l’INA). Lors de cet événement, un documentaire intitulé « Il suffit d’écouter les femmes » a été présenté, réalisé à partir de témoignages inédits recueillis par l’INA sur l’avortement clandestin. À travers de telles initiatives, l’INA démontre en 2025 sa volonté de relier le passé au présent et de transmettre aux jeunes générations l’écho des grands combats sociaux de l’histoire contemporaine.
Sauvegarder les archives : la course à la numérisation
Si l’INA peut aujourd’hui offrir au public un accès direct à des milliers d’heures d’archives en ligne, c’est grâce à un colossal travail de numérisation entamé il y a plus de vingt ans. À la fin des années 1990, l’institut fait face à une urgence : la dégradation progressive des supports analogiques menace de faire disparaître une large partie de son patrimoine audiovisuel. En 1999, avec le soutien de l’État, l’INA lance un ambitieux plan de sauvegarde et de numérisation de ses collections historiques (PSN). Ce plan a permis de convertir en numérique quelque 335 000 heures de programmes de télévision et près de 500 000 heures de radio enregistrées sur bandes ou films fragiles. Au fil des années 2000, les laboratoires de l’INA ont travaillé d’arrache-pied pour transférer sur fichiers numériques ces trésors menacés, des journaux télévisés aux dramatiques radio, en passant par les concerts filmés.
L’objectif fixé fut atteint : d’ici 2018, l’INA avait numérisé la totalité de ses archives identifiées comme en danger de dégradation, soit environ 835 000 heures de programmes sauvés de l’oubli. La France est ainsi devenue l’un des rares pays au monde à avoir entièrement préservé sa mémoire audiovisuelle nationale sur support numérique. Ce basculement technologique a révolutionné la manière dont l’INA exploite ses fonds : il est désormais possible de diffuser largement ce patrimoine et de le valoriser à travers internet, les réseaux sociaux, des produits dérivés ou des productions documentaires. Le site INA.fr, lancé dès 2006, offre aujourd’hui un accès en ligne à des dizaines de milliers d’archives radio et TV emblématiques, consultables par tous.
Par ailleurs, forte de son expérience, l’INA propose son savoir-faire à d’autres détenteurs d’archives audiovisuelles. L’institut a noué des partenariats pour prendre en charge la sauvegarde des fonds d’organismes tels que l’AFP, la chaîne TF1 (pour ses JT et archives sportives) ou Radio Nova. Il accueille également des collections audiovisuelles privées à valeur historique ou sociologique (comme des captations des grands théâtres nationaux, ou les photographies des Rencontres d’Arles) afin d’en assurer la conservation sur le long terme. Cette ouverture témoigne de la reconnaissance de l’expertise technique de l’INA en matière de numérisation et de restauration d’archives.
La mission de sauvegarde concerne également les supports filmiques et vidéo grand public, souvent conservés par les particuliers. L’INA a entrepris de restaurer et numériser d’anciennes bobines de film amateur (8 mm, Super 8) ou des cassettes vidéo VHS, qui contiennent aussi une part du patrimoine visuel populaire. Le temps presse pour ces médias d’un autre âge : les pellicules se dégradent chimiquement, les magnétoscopes disparaissent, rendant la lecture des vieux enregistrements de plus en plus difficile. Consciente de cet enjeu, l’INA s’efforce en 2025 de sauvegarder ces témoignages du quotidien filmés par les Français, en complément de ses archives professionnelles. Le mouvement dépasse d’ailleurs le seul cadre institutionnel : de nombreuses entreprises spécialisées proposent désormais aux particuliers de transférer leurs souvenirs audiovisuels sur support numérique. Ainsi, Keepmovie, société de numérisation de cassettes, illustre l’essor de ce service pour sauver les films familiaux sur VHS ou Super 8 de l’obsolescence. La convergence de ces efforts souligne une prise de conscience générale : il y a urgence à numériser les images du passé pour les transmettre à l’avenir avant qu’elles ne s’effacent.

Archives 2.0 : l’INA à l’heure de l’intelligence artificielle
Sauvegarder les archives n’est que le début du voyage : encore faut-il les explorer et en extraire du sens. En 2025, l’INA innove en exploitant les technologies d’intelligence artificielle (IA) pour analyser ses gisements d’images et de sons accumulés depuis des décennies. À l’automne 2024, l’Institut a lancé la plateforme data.ina.fr, un site web inédit permettant de scruter l’actualité médiatique sous forme de données et de graphiques interactifs. Pour ce faire, l’INA a mobilisé des algorithmes d’IA capables de transcrire, découper et indexer automatiquement les journaux télévisés, débats, magazines et reportages de son fonds. Plus de 700 000 heures de contenus audiovisuels ont ainsi été traitées par des outils de reconnaissance vocale et d’analyse textuelle, couplés à des solutions développées en interne. Ce travail titanesque, affiné ensuite par des vérifications humaines, ouvre la voie à de nouvelles perspectives de recherche dans les archives.
La démarche est expliquée par Camille Pettineo, responsable éditoriale de data.ina.fr : il s’agit de proposer « un regard inédit sur des décennies d’archives », en dégageant les grandes tendances médiatiques d’hier et d’aujourd’hui. Concrètement, la plateforme permet de visualiser l’évolution de la fréquence d’un mot ou d’un thème dans les médias au fil du temps, ou encore de voir combien de fois certaines personnalités ont été citées sur les plateaux TV. Quels sujets dominaient l’actualité des années 1980 par rapport à celle de 2020 ? Quelles régions ou pays étaient les plus couverts dans les journaux télévisés, et comment la situation a-t-elle évolué ? Autant de questions auxquelles data.ina.fr apporte des éléments de réponse, grâce à la datavisualisation appliquée aux contenus d’archives.
Ce projet illustre la transition de l’INA vers de nouvelles fonctions : plus qu’un centre d’archives, l’institut devient aussi un producteur d’analyses et de connaissances sur l’information. Il mobilise pour cela une équipe de recherche interne qui intègre progressivement l’IA dans les outils de documentation. Loin de menacer le travail des documentalistes, ces technologies automatisent les tâches fastidieuses (transcription, repérage de visages ou de logos dans les vidéos, etc.) et libèrent du temps pour une valorisation plus éditoriale des archives. En 2025, l’INA prévoit d’enrichir sa plateforme data.ina.fr tous les six mois en intégrant de nouveaux pans historiques de ses collections, poursuivant ainsi l’ambition d’offrir au public un outil de compréhension de l’évolution médiatique sur le long terme.
Parallèlement, l’INA continue d’alimenter régulièrement son Baromètre de l’actualité. Chaque début d’année, ce rapport dresse un bilan chiffré de l’année écoulée dans les médias français, s’appuyant sur les données compilées par l’institut. L’édition 2025 de ce baromètre a par exemple analysé la couverture médiatique des élections européennes et américaines, comparé la visibilité de plusieurs Premiers ministres ou encore quantifié l’essor du mouvement #MeToo dans les journaux télévisés. Autant de données qui témoignent de la manière dont l’INA met ses archives au service du décryptage de l’actualité. Cette approche de journalisme augmenté par les archives renforce le rôle de l’INA comme médiateur entre le passé et le présent : grâce aux outils numériques, les archives deviennent un miroir pour analyser notre société contemporaine.
Un acteur culturel et éducatif de premier plan
En 2025, l’INA confirme également sa vocation à diffuser la culture et le savoir autour de l’audiovisuel. Outre ses missions patrimoniales, l’Institut s’attache à partager ses trésors avec le grand public et à former les professionnels de demain. Sa plate-forme de streaming Madelen, lancée en 2020, continue d’enrichir son catalogue de programmes patrimoniaux : séries, téléfilms, concerts ou émissions cultes issus des archives de la télévision française, proposés à la demande via un abonnement. L’INA se positionne ainsi en véritable média patrimonial, offrant une seconde vie aux contenus d’autrefois en les adaptant aux usages du numérique. Sous l’impulsion de son président, l’institut a développé ces dernières années une présence active sur YouTube et les réseaux sociaux, multipliant les séries de vidéos d’archives thématiques pour toucher un public plus jeune. Des chaînes YouTube dédiées (INA Histoire, INA Société, INA Sport, etc.) publient chaque semaine des extraits d’archives contextualisés, qui rencontrent un franc succès d’audience. Cette stratégie de diffusion multi-plateformes contribue à populariser le patrimoine audiovisuel auprès d’une nouvelle génération d’internautes.
Sur le plan éducatif, l’INA renforce ses actions de transmission. Son département formation, héritier d’une des missions fondatrices de l’institut, propose de nombreux stages et cursus à destination des professionnels des médias et de la culture. Qu’il s’agisse de former au métier d’archiviste audiovisuel, d’enseigner les techniques de restauration filmique ou d’apprendre aux journalistes l’utilisation d’outils de vérification, l’INA adapte son offre aux besoins actuels. En 2025, des ateliers portent par exemple sur la conduite de projets de numérisation d’archives audiovisuelles (indispensable pour les institutions régionales qui souhaitent sauvegarder leurs fonds locaux). L’INA s’implique par ailleurs dans l’éducation aux médias auprès des jeunes, via des partenariats avec l’Éducation nationale. Grâce à Lumni et à ses propres publications en ligne (comme la Revue des médias), il fournit des contenus pédagogiques pour développer l’esprit critique face aux images, expliquer l’histoire de la télévision, ou décrypter les rouages de l’information. Son engagement aux côtés de France Télévisions lors de la master class sur Simone Veil mentionnée plus haut en est une illustration concrète. En faisant dialoguer lycéens et experts autour de thèmes de société en lien avec ses archives, l’INA joue pleinement son rôle de passeur de mémoire et de savoir.
Enfin, l’INA demeure un acteur culturel de terrain grâce à ses événements et expositions. À Bry-sur-Marne, sur son site principal, l’institut organise régulièrement des visites, projections et rencontres autour de ses collections. En 2025, on peut y découvrir des expositions retraçant l’évolution de la télévision française depuis 1975, ou plongeant dans les coulisses de grandes émissions d’antan. L’INA participe aussi à de nombreux festivals et manifestations, proposant par exemple des séances d’archives restaurées dans des festivals de cinéma, ou collaborant avec des musées sur des rétrospectives audiovisuelles. Toutes ces actions témoignent d’une même ambition : rendre vivante la mémoire audiovisuelle et la mettre au service du débat public comme du divertissement.
Turbulences à la tête de l’INA en 2025
Cette année anniversaire n’a pas été de tout repos pour l’institution, confrontée à une crise sans précédent au sommet. Le PDG de l’INA, Laurent Vallet, en poste depuis 2015, a vu son mandat renouvelé en mai 2025 pour cinq années supplémentaires. Sur proposition de la ministre de la Culture, le Conseil des ministres du 15 mai a en effet décidé de reconduire M. Vallet, saluant la stabilité de sa gouvernance et les transformations menées sous sa présidence. Laurent Vallet, 55 ans, avait su consolider le rôle patrimonial de l’INA tout en le faisant évoluer à l’ère numérique. Son bilan faisait état d’un institut modernisé, présent sur les nouveaux médias et fort de réussites comme le lancement de Madelen ou la popularité des chaînes INA sur internet.
Pourtant, quelques mois à peine après cette reconduction, l’INA a été ébranlé par une affaire retentissante. Fin juillet 2025, Laurent Vallet a été interpellé par la police à son domicile parisien, dans le cadre d’une enquête pour achat de stupéfiants. D’après une information révélée le 12 août par la presse, le dirigeant de l’INA aurait été surpris en flagrant délit d’achat de cocaïne auprès d’un mineur, lors d’une livraison organisée à son domicile. Aussitôt informée, la ministre de la Culture Rachida Dati a suspendu le PDG de ses fonctions fin août. Laurent Vallet, jusqu’alors haut fonctionnaire respecté, s’est retrouvé mis en cause pour un comportement personnel illégal, provoquant la stupeur parmi les 900 collaborateurs de l’établissement.
Face à la gravité de la situation, M. Vallet a présenté sa démission dans les jours qui ont suivi sa suspension. Dans un communiqué adressé début septembre, il a reconnu sa faute et exprimé ses regrets pour « cette fin trop brutale » dont il se dit « seul responsable ». Il a expliqué vouloir se consacrer pleinement à l’injonction thérapeutique qui lui a été imposée par la justice en alternative aux poursuites pénales. En effet, pour un usager interpellé pour la première fois, la loi prévoit généralement une orientation vers des soins plutôt qu’une condamnation classique – ce qui a été le cas pour Laurent Vallet selon le parquet de Paris. La chute soudaine de ce dirigeant, qui venait tout juste d’entamer son troisième mandat, a plongé l’INA dans une période d’incertitude. Rachida Dati a toutefois tenu à saluer « la réussite et le professionnalisme » de celui qui a « profondément transformé l’INA » durant ses dix années à sa tête, insistant sur le fait que l’institut demeure solide malgré l’épreuve.
Pour assurer la continuité du service public, la ministre de la Culture a nommé début septembre Agnès Chauveau en qualité de présidente par intérim de l’INA. Directrice générale déléguée de l’Institut, Agnès Chauveau connaît bien la maison et aura pour mission de stabiliser l’organisation le temps que le gouvernement désigne un nouveau PDG. Ce changement forcé de gouvernance intervient à un moment charnière, alors même qu’une réforme d’ampleur de l’audiovisuel public français est en discussion.
Vers une mutation de l’audiovisuel public
Au-delà des remous internes, 2025 est une année de débats stratégiques pour l’INA et ses consœurs de l’audiovisuel public. Le gouvernement travaille en effet sur un projet de loi visant à regrouper sous une même holding baptisée France Médias les principales entités publiques du secteur : France Télévisions, Radio France, France Médias Monde et l’INA. Cette réforme, portée par la ministre Rachida Dati, entend renforcer les synergies et la cohérence de l’audiovisuel public à l’ère numérique, en mutualisant certaines fonctions au sein d’une structure commune. L’INA, qui a parfois pu apparaître en marge en raison de son statut particulier d’EPIC (Établissement public industriel et commercial), serait ainsi pleinement intégré dans le nouvel ensemble. Laurent Vallet lui-même, avant sa chute, s’était rallié à l’idée de ce rapprochement, estimant que l’institut risquerait d’être affaibli en restant « en dehors » d’un groupe unifié.
Le projet France Médias n’est pas totalement neuf : il figurait déjà dans les réflexions du précédent quinquennat et un organisme du même nom avait même été esquissé en 2019. Mais il a longtemps suscité des réserves, notamment de la part de certaines instances et des syndicats, inquiets d’une perte d’indépendance éditoriale ou d’une dilution des identités propres à chaque média. En 2024-2025, le gouvernement a remis le sujet sur la table, avec l’objectif de faire aboutir la réforme via le Parlement. En ce début d’automne 2025, le texte est en cours d’examen : la commission des affaires culturelles du Sénat a donné un premier feu vert, tandis qu’à l’Assemblée nationale les débats s’annoncent vifs. L’issue reste incertaine, tant les contraintes de calendrier législatif sont serrées.
Pour l’INA, l’enjeu est crucial. Intégrer France Médias impliquerait de travailler plus étroitement avec les rédactions de France Télévisions et Radio France, par exemple pour partager des outils technologiques ou coordonner les politiques d’archives et de formation. Cela pourrait aussi garantir des financements mutualisés pour les projets numériques d’ampleur, ce qui intéresse l’institut au premier chef. En même temps, l’INA tient à préserver sa spécificité patrimoniale et son expertise unique, qui risqueraient de passer au second plan dans un grand groupe focalisé sur la diffusion en direct. Les prochains mois seront déterminants : ils diront si la réforme aboutit et sous quelle forme. En attendant, la présidente par intérim Agnès Chauveau veille à ce que l’INA poursuive sa mission sans relâche, malgré l’incertitude institutionnelle.
En somme, l’année 2025 s’affirme comme un tournant dans l’histoire de l’INA. À 50 ans, l’institut conjugue un héritage riche et une adaptabilité remarquable face aux évolutions technologiques et sociétales. Alors que les bobines de film et les cassettes cèdent la place aux données numériques, l’INA réaffirme son rôle de gardien de la mémoire et d’acteur de l’innovation au service du public. Entre célébration du chemin parcouru et préparation de l’avenir – non sans quelques soubresauts en chemin – l’actualité de l’INA en 2025 témoigne d’une institution vivante, ancrée dans son époque tout en portant le témoignage des époques passées. Les défis ne manquent pas, mais l’INA aborde son prochain demi-siècle avec la conviction renouvelée que connaître le passé aide à éclairer le présent.